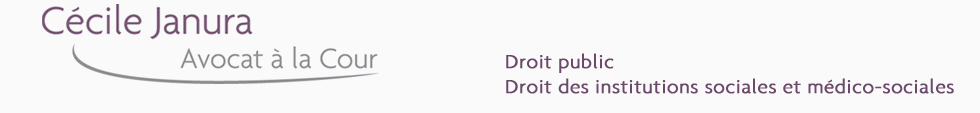Actualités
Consultez mes dernières interviews, interventions et commentaires.
Qu’en est-il du droit au redoublement des « recalés » au Baccalauréat ?
Deux ans après l’adoption du décret qui devait y remédier (cf. décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015), les refus d’inscription des lycéens ayant échoué au baccalauréat sont plus que jamais d’actualité.
De nombreux lycéens en effet, non seulement n’ont toujours pas la possibilité de se réinscrire dans leur lycée d’origine, mais en outre, ne trouvent aucune place dans les établissements alentours qui affichent complet.
Pourtant, l’article D. 331-42 du code de l’éducation prévoit désormais que « tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen ».
Dans sa rédaction actuelle, le code de l’éducation ne subordonne donc plus l’inscription de ces élèves à l’existence préalable de places disponibles, mais érige cette réinscription en un véritable droit qui, sous réserve que l’élève ait informé son lycée de son échec à l’examen, ne saurait être méconnu sans être sanctionné par le juge administratif.
Par le passé, alors même que la réinscription n’était possible que sous réserve des places disponibles, plusieurs tribunaux ont eu l’occasion de suspendre en urgence des refus d’inscription d’élèves en classe de terminale en retenant que de telles décisions risquaient d’entraîner pour les élèves concernés la perte d’une année scolaire, et d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de les inscrire (cf. par ex : TA Paris, 22 janvier 2001, n° 0019658 ; TA Strasbourg, 14 août 1996, n° 961676).
Il devrait en être jugé de même à l’heure où plus aucune condition liée aux places disponibles ne figure désormais dans le code de l’éducation.
Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (NOR : RDFF1708728C)
Cette circulaire qui précise le sens et la portée pour les agents publics du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité inscrits à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-433 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Elle présente également les nouveaux outils de formation, de communication, de conseil et de veille mis en place pour permettre aux agents publics d’exercer leurs fonctions dans le respect de ces obligations.
Répartition des compétences sur un transfert de salariés à une personne publique (TC 9 janvier 2017, 4073)
Le litige était lié à la reprise par le département de la Réunion des activités de l’Association régionale d’accompagnent social territorialisé (ARAST).
Le Tribunal des conflits vient de préciser la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire dans le cas où une personne publique qui a repris les activités d’une personne privée refuse de proposer un contrat aux salariés de la seconde en application de l’article L. 1224-3 du code du travail.
Il rappelle qu’en principe, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre employeur de poursuivre les contrats de travail qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé.
Toutefois, « conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats ».
Le Tribunal conclut donc que « lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’à l’issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel », conformément à ce qu'avait déjà jugé la Cour de cassation (Soc. 22 sept. 2015, n° 13-26.032).
Le Conseil d’État a jugé que l’administration peut licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser sur d’autres fonctions (CE, 18 janvier 2017, n° 390396).
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par un professeur de mathématiques. Il a estimé que « si le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose de chercher à reclasser sur d’autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ».
L’ordonnance du 19 janvier 2017 (publie au JO du 20 janvier 2017) modifie la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires, notamment en y ajoutant une définition des notions d’accident de service, d’accident de trajet et de maladie contractée en service.
L’accident de service est défini comme un accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service, et l’ordonnance consacre la présomption d’imputabilité reconnue par le Conseil d’Etat (CE Sect. 16 juillet 2014, n° 361820) qui figurera désormais à l’article 21 bis du statut.
L'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire est imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, que cet accident s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.
Enfin, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau, ou pour celles qui n’y sont pas mentionnées, toute maladie dont le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En cas d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie contractée en service, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1083 portant statut des fonctionnaires prévoit désormais que le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service dont le régime juridique reprend l’essentiel des garanties dont bénéficiaient déjà jusqu’alors les fonctionnaires en accident de service ou maladie professionnelle, puisqu’il est prévu que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite, qu’il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, et que la durée de son congé est assimilée à une période de service effectif.
Pas de révolution donc dans le régime juridique des accidents et maladies en lien avec le service, mais une clarification dans la délimitation de leur champ d’application.
Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les établissements sociaux et médicaux-sociaux et les établissements de santé de droit privé
Publication au JO du 14 décembre 2016 du décret d’application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé instituant un contrôle des juridictions financières sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou les organismes de sécurité sociale.
Ce contrôle, exercé par la Cour des comptes ainsi que par les chambres régionales et territoriales des comptes, peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Le décret précise que lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte alors sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
|
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution (Cons. constit. 9 décembre 2016, 2016-601 QPC) Dans le cadre du contrôle qu’il exerce à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité d’une loi ou de toute disposition à valeur législative qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, comme peut l’être l’ordonnance du 2 février 1945, aux Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Il l’a fait dans sa décision du 9 décembre 2016 (n° 2016-601 QPC), en contrôlant la conformité de l’article 22 de l’ordonnance susmentionnée au PFRLR que constitue la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Dès lors, le Conseil constitutionnel considère qu’en « permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause », l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit que « le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel », est contraire au principe constitutionnel sus-rappelé, et partant aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, entraîne actuellement son incarcération immédiate à l’issue de l’audience quel que soit le quantum de la peine d’emprisonnement (alors même que pour les majeurs, les mandats de dépôts ne peuvent pas être prononcés pour des peines inférieures à un an de prison ferme ! ), y compris en cas d’appel.
Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, pouvant contribuer précisément au relèvement éducatif et moral, et méconnaît dès lors les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
Le contentieux de la tarification des lieux de vie et d'accueil, commentaire de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 septembre 2016 (CE, 26 septembre 2016, n° 398347) Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médicaux-sociaux au sens du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont néanmoins en vertu du III du même article, soumis à plusieurs obligations et autorisations imposées à ces établissements et services, ainsi qu’à des règles de financement inscrites dans ce même code de l’action sociale et des familles, comme en atteste notamment l’article D. 316-5 relatif au forfait journalier. Dès lors, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande tendant à la suspension d’un arrêté départemental fixant le forfait journalier d’un lieu de vie et d'accueil en a déduit dans un arrêt rendu le 26 septembre 2016 (n° 398347) que seules les juridictions tarifaires (et non les juridictions administratives) sont compétentes pour en connaître : « (...) que le législateur a ainsi entendu que, même lorsqu'ils ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médicaux-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les lieux de vie et d'accueil soient soumis à plusieurs des dispositions applicables à ces établissements et services, en particulier à des règles de tarification ; que cette tarification prend la forme d'un forfait journalier, qui est l'une de celles que prévoit l'article R. 314-8 de ce code pour la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et qui est arrêtée par l'autorité de tarification au vu d'un budget prévisionnel et à un niveau destiné à permettre la prise en charge des dépenses nécessaires à l'accueil des personnes qui leur sont adressées », avant d’en conclure « que le recours contre une décision par laquelle une autorité de tarification mentionnée à l'article L. 351-1 du même code, au nombre desquelles le président du conseil départemental, détermine le forfait journalier d'un lieu de vie et d'accueil relève des litiges que cet article attribue à la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ». Cette extension du domaine de compétence des tribunaux de la tarification sanitaire et sociale n’aurait rien de problématique pour les requérants s’il leur était possible de saisir ces juridictions en référé-suspension (ce qu’ils avaient fait devant le tribunal administratif de Toulouse), procédure d’urgence qui n’a malheureusement aucun équivalent en matière de contentieux tarifaire... Nouveaux risques en matière de gestion des personnels ?
|
| Consulter l'article complet de Maître JANURA |
La laïcité : quelle traduction juridique dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Les attentats de janvier 2015 ont appelé bon nombre de professionnels à s’interroger sur les phénomènes de radicalisation, et à repenser la place du principe de laïcité dans leurs pratiques.
Quelques mois plus tôt, c’est la très médiatique affaire de la crèche « Baby Loup » qui avait déjà relancé le débat sur l’application du principe de laïcité au sein des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Et avec ce principe de laïcité, que rappelle le tout nouveau code des relations du public et de l’administration (art. L. 100-2 : « L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial »), se pose, bien évidemment, la question de la définition du service public.
Les conférences portant sur la laïcité que Maître Cécile JANURA a été invitée à faire auprès de nombreuses associations, fédérations, administrations, ainsi qu’au sein de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP de Rennes) courant 2015, ont été synthétisées dans un article qu’il est possible de consulter en cliquant ci-dessous.
| Consulter l'article complet de Maître JANURA |
Présenter et défendre son compte administratif
Chaque année avant le 30 avril, le gestionnaire d’établissement social ou médico-social doit présenter les résultats de l’exercice budgétaire de l’année précédente en adressant un compte administratif établi selon un cadre normalisé de présentation fixé par arrêté ministériel , à partir duquel l’autorité de tarification décidera du montant et de l’affectation des résultats excédentaires ou déficitaires du budget général, ou le cas échéant, des budgets principal et annexe de l’établissement.
L’article de Maître Cécile JANURA, publié dans la revue Direction(s), rappelle les règles et formalité de présentation du compte administratif des établissements sociaux et médico-sociaux, l’étendue et les limites des pouvoirs de l’autorité de tarification (en matière d’affectation du résultat, ou de réformation du montant de celui-ci) et offre de précieux conseils aux gestionnaires pour justifier les dépassements de dépenses autorisées.
De plus, l’article examine les modalités de recours des gestionnaires d’ESSMS en cas de refus d’approbation de leurs comptes administratifs, en rappelant notamment que la contestation ne peut avoir lieu qu'à l'occasion du recours dirigé contre l'arrêté fixant le tarif constatant la reprise du résultat, le plus souvent en année N + 2., et Maître Cécile JANURA présente un certain nombre de moyens susceptibles d’être utilisés auprès du juge du tarif.
Enfin, elle met en garde les gestionnaires contre les « promesses » de l’autorité tarifaire qui lors de la notification d’un arrêté de tarification indique parfois qu’elle reprendra certaines dépenses (non autorisées) au compte administratif, alors qu’elle n’en a pas l’obligation… sauf lorsqu’il aura été jugé que la reprise d’un résultat déficitaire est due à l’organisme gestionnaire en raison de l’insuffisance de tarification qu’il l’a généré.
Consulter l'article de Maître Cécile JANURA dans la revue Direction(s), n° 129, mars 2015, pages 28-29
TARIFICATION, LVA dans l'incertitude
Consulter l'interview de Maître Cécile JANURA, et ses commentaires sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2014 statuant sur la légalité du décret du 4 janvier 2013 organisant la tarification des lieux de vie et d'accueil, in Direction(s), n° 128, février 2015, page 7
Mener un contentieux en matière d'appels à projets
L'article répond aux questions suivantes :
Qui peut former un recours contentieux contre l'autorisation délivrée à l'issue d'une mise en concurrence ?
Sous quelle forme et dans quel délai doit-on agir ?
Quels moyens sont susceptibles d'être soulevés à l'encontre de telles autorisations ?
Dans quelle mesure peut-on envisager le référé suspension ?
Quelles sont les incidences pour le titulaire de l'autorisation ?
Consulter l'article de Maître Cécile JANURA dans la revue Direction(s), n° 125, novembre 2014, pages 32-33
Centres éducatifs fermés : des décisions du juge du tarif en « demi-teinte »…
La circulaire budgétaire du 17 février 2012 qui ramène la norme d’encadrement des centres éducatifs fermés de 27 à 24 ETP pour 12 places est au cœur des contentieux engagés depuis près de deux ans auprès du juge du tarif.
Si les premières décisions ont pu apparaître très décevantes (1) , le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Lyon a décidé, plus récemment, de réformer l’arrêté fixant le montant de la dotation globale d’un centre éducatif fermé en considérant que la possibilité pour l’autorité de tarification de se prévaloir de la circulaire du 17 février 2012 « ne dispense pas ladite autorité de l’obligation de motiver les modifications qu’elle entendait apporter aux propositions de l’établissement »(2) .
S’il a été jugé, dans cette affaire, que le préfet de la Drôme n’a pas légalement justifié les abattements qu’il a pratiqués sur le groupe de dépenses du personnel par rapport aux besoins exprimés par l’établissement, le juge du tarif, qui a privilégié ainsi l’application d’un principe fondamental du droit de la tarification (celui du financement des charges justifiées par les nécessités du fonctionnement normal, de la réalité des besoins et des mission de la structure), n’a cependant nullement entendu remettre en cause la « norme » posée par la circulaire en question.
De même que le juge bordelais, mais plus explicitement (3) , le TITSS de Lyon confirme en effet l’opposabilité de cette circulaire budgétaire alors que l’association gestionnaire, comme bien d’autres, avait soutenu le contraire (4) , et reconnaît même son caractère impératif.
Sachant que personne ne conteste par ailleurs que ses dispositions limitant le nombre d’ETP à 24 revêtent un caractère général, ladite circulaire ne peut dès lors qu’être soumise au régime des actes réglementaires (5) , ce qui signifie : d’une part, que l’autorité dont elle émane doit disposer du pouvoir règlementaire (ce qui ne semble pas être le cas du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse), d’autre part, que ses dispositions ne doivent pas contrevenir à des principes ou règles de valeur supérieure. Or, la circulaire du 17 février 2012 est en totale contradiction avec la liberté de gestion garantie par le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
Outre la circonstance que la tarification par dotation globale de financement doit permettre de s’inscrire dans une enveloppe globale attribuée à chaque établissement en fonction d’indicateurs et de la situation propre de chaque structure, et qu’elle ne rentre donc pas dans une logique de référentiel emploi strict, chaque association restant en effet libre d’organiser ses équipes dans le cadre de l’enveloppe qui lui est allouée, la norme posée par la circulaire méconnaît en effet la liberté de gestion garantie par le décret du 22 octobre 2003 qui notamment, en autorisant l’établissement à effectuer des virements entre groupes fonctionnels (6) tout en supprimant l’approbation des variations du tableau des effectifs, permet au gestionnaire d’avoir une gestion des ressources humaines adaptée (et ajustée) aux besoins et projet d’établissement.
Force est de constater cependant qu’avec la circulaire du 17 février 2012 qui impose que le montant de la dotation globale soit calculé sur une base de 24 ETP, l’association n’est plus libre de déterminer ses effectifs - puisque, quelle que soit la nature des postes, le nombre d’ETP ne devra pas dépasser 24 pour 12 places - sauf à faire la démonstration circonstanciée des besoins spécifiques de la structure, sans être utilement contredit par l’autorité tarifaire elle-même.
On peut alors espérer que les conclusions du rapport de la mission d’évaluation des CEF (7) qui a été rendu public en fin d’année 2013 (suite aux craintes exprimées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté), qui préconise notamment au moins 27 ETP par centre éducatif fermé, aideront les structures à justifier leur besoins en personnels, tant que le juge du tarif ne se sera pas prononcé sur la légalité même de la « norme » contenue dans la circulaire budgétaire du 17 février 2012.
(1) cf. TITSS de Bordeaux, n° 2012-82-3, ADSEA du Tarn-et-Garonne, 12 juin 2013.
(2) cf. TITSS de Lyon, n° 12-26-28, ADSEA de la Drôme, 17 février 2014.
(3) Le TITSS de Bordeaux s’étant en effet borné à justifier cette opposabilité par la seule circonstance que les appels à projets pour la création de nouveaux CEF limitent le tableau des emplois à 24 ETP…
(4) Sur le fondement d’une jurisprudence bien établie de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS, 5 février 2010, Préfet de l’Ain, n° A.2005.046 ; CNTSS, 27 mars 2009, Préfet de l’Ain C/ Association OSER, n° A.2005.025 ; CNTSS, 20 novembre 2009, Association ADEP c/ préfet de la Loire, n° A.2004.053).
(5) cf. CE, sect. 18 décembre 2002, Duvignères, Rec. p. 463.
(6) cf. art. 43 du décret, désormais codifié à l’art. R.314-44 du code de l’action sociale et des familles)
(7) Rapport IGAS/IGSJ/IPJJ, Mission sur l’évaluation des centres éducatifs fermés dans le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants, Janvier 2013, p. 35 à 38.
Le secret professionnel partagé
(Synergies locales de la FNARS Midi Pyrénées du 21 novembre 2013)
Nulle Ecoute sans confiance.
Nulle confiance sans écoute.
Nul accompagnement sans confiance.
Cette relation de confiance, sans laquelle nul travail social n’est possible, interroge directement l’obligation au secret professionnel auquel sont astreints nombre d’intervenants sociaux. L’ensemble des travailleurs sociaux n’y est cependant pas soumis. De plus, cette obligation de taire ce qui a pu être appris au cours de l’exercice d’une profession, ou plus largement, depuis la réforme du code pénal de 1992, à raison d’une fonction ou d’une mission, même temporaire (art. 226-13 du code pénal), connaît de nombreuses exceptions. Certaines sont expressément prévues par la loi, d’autres sont légitimées par les circonstances. Bien souvent appréhendée (à tort) comme une garantie pour les intervenants sociaux en terme de responsabilités, l’existence de ces exceptions occulte en réalité la finalité du secret professionnel en matière d’action sociale qu’est la protection de l’usager. Le secret professionnel est en effet au cœur de la mission d’action sociale elle-même. Lorsque la prise en charge de l’usager suppose un travail en équipe, ou des interventions ou partenariats interinstitutionnels, il est alors parfois question de « secret partagé ». Cette notion de « secret partagé » n’a cependant aucune existence légale, mais il est apparu que c’est en instaurant une définition « fonctionnelle » du secret professionnel que le code pénal permet, en réalité, le partage d’informations à caractère secret. Ce partage n’est pas sans limites néanmoins, y compris entre personnes astreintes au secret professionnel, puisqu’il n’est justifié que lorsqu’il est en rapport avec la mission d’aide ou de soins. « Tout ne peut pas être échangé entre tous sans remettre en cause l’équilibre de notre dispositif de protection des populations fragiles et le disqualifier » (J-P ROSENCZVEIG et P VERDIER, le secret professionnel en travail social et médico-social, Dunod, 5ème éd., 2011). Ce partage d’informations, qui seul permet parfois la prise en charge globale de l’usager garantie par la loi du 2 janvier 2002, au delà des obligations légales et déontologiques liées au secret dont on n’est que « dépositaire », suppose alors paradoxalement un engagement personnel des travailleurs sociaux, mais également un engagement institutionnel lorsqu’il impacte la gestion de la structure elle-même.
| Consulter l'intervention complète de Maître JANURA |
Jurisprudence Tarifs plafonds
Par un arrêt du 17 juillet 2013 (CE, 17 juillet 2013, n° 344035, Association des paralysés de France (APF) et autres), le Conseil d’Etat a statué sur six requêtes présentées par un collectif d’associations gestionnaires d’ESAT contre plusieurs arrêtés interministériels fixant les tarifs plafonds prévus à l’article L. 314-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles.
Le Conseil d’Etat retient que pour l’exercice 2012, les autorités ministérielles ont commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant les tarifs plafonds « au même niveau pour la quatrième année consécutive », qu’elles ont déterminé uniquement en fonction d’une étude de coûts réalisée à partir des données relatives à l’exercice 2008.
Il n’annule cependant que l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour l’exercice 2012 … alors que le même raisonnement aurait pu être tenu au soutien de l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2011.
Il n’est pas à exclure dès lors que les conséquences financières de l’annulation de tels arrêtés aient été prises en compte pour limiter celle-ci au seul arrêté du 2 mai 2012.
En effet, l’annulation d’un tel arrêté implique sa disparition avec effet rétroactif, ce qui signifie que l’arrêté du 2 mai 2012 est censé n’avoir jamais existé, et par conséquent, que les dotations qui ont été allouées pour l’exercice 2012 selon les règles du tarif plafond doivent être regardées comme étant dépourvues de base légale.
| Consulter l'intégralité du commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat par Maître JANURA (commentaire intégral de l'arrêt) |
|
| Consulter l'interview de Maître JANURA par la Revue Direction[s], www.directions.fr Les tarifs plafonds enfin revalorisés - Direction[s] n° 121 juin 2014 |